Laurent Raphaël
London Calling: J-85 avant le Virgin Money London Marathon
Le 26 avril prochain, le rédac chef de Focus Laurent Raphaël relèvera un sacré défi: venir à bout des 42,195 kilomètres du Virgin Money London Marathon, l’un des plus prestigieux et des plus populaires de la planète. Des larmes et de la sueur en perspective. Mais aussi une aventure humaine au long cours dont il nous raconte la genèse dans ce journal de bord en vue subjective, entre réflexions à grandes enjambées, introspection au grand air et catalogue de tortures, le tout agrémenté de digressions sur la course à pied au cinéma et dans la littérature. Cours, Laurent, cours!
Dans cet article:
- Born to run
- Le coin lecture (Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, de Haruki Murakami)
- Travaux pratiques
1. Born to run

Pas une semaine ne passe sans que je me demande ce que je fais là, tout seul dans le froid piquant du matin, à la merci une fois sur deux d’un crachin vicieux, à bouffer des kilomètres sur un parcours dont je connais par coeur le moindre caillou. Après des années de running, au rythme de une, deux, trois ou même quatre sorties hebdomadaires comme aujourd’hui, je n’ai toujours pas la réponse. Et je ne m’attends pas à la trouver de sitôt.
J’ai un boulot haut perché sur l’échelle du bonheur au travail (sous-entendu: passionnant et chronophage), j’ai des enfants, quelques vices impunis comme la lecture et le cinéma, et des articulations qui commencent à rouiller sérieusement. Bref j’ai une vie de fou comme tout le monde, un peu trop sur le fil du rasoir à mon goût, et je m’arrange pourtant pour y caser encore quatre séances par semaine de galop à intensité variable. Et cela sans obligation, sans prescription médicale, juste pour le plaisir (enfin, façon de parler, on y reviendra).
C’est donc qu’il doit y avoir une force supérieure qui me pousse dès potron-minet, été comme hiver, sur le sentier pédestre de la guerre. Oui, de la guerre. Pas contre quelqu’un ni contre quelque chose. Sinon contre moi-même. Une guerre perdue d’avance en plus. Car celui qui court en amateur admet d’emblée que la défaite n’est pas juste une hypothèse de travail comme dans les autres sports, mais qu’elle est inéluctable. A fortiori à 45 balais qui font de moi un vétéran.
Contrairement à ces Africains de l’Est qui courent pour échapper à la misère (les 50 meilleurs marathoniens du monde l’an passé venaient tous de cette région!), je n’ai aucune chance de gagner quoi que ce soit, hormis peut-être des regards compatissants de mes proches quand ils voient les souffrances que je m’inflige gratuitement. Pour paraphraser Gérard Ejnès dans son savoureux Dictionnaire absurde du marathon, mon palmarès en 25 ans peut se résumer ainsi: une petite dizaine de 20 km de Bruxelles (meilleur temps: 1h12 il y a de ça bien longtemps, aujourd’hui je tourne plutôt autour de 1h27), une poignée de courses du même acabit ici et ailleurs en Europe, un marathon et… zéro victoire. La gagne n’est définitivement pas le carburant qui fait tourner le moteur du coureur de fond lambda.

Je ne pars donc pas me mesurer aux autres, je pars me mesurer à moi-même, le couteau entre les dents. Chacun sa motivation: perdre du poids, améliorer une santé vacillante, effacer un échec sentimental… Dans mon cas, c’est autre chose, un truc indicible niché au fond d’un placard intime. Comme une réponse à un stimuli inscrit dans une zone mal éclairée de mon patrimoine génétique. « T’as juste besoin de ta dose de dopamine« , me lance en ricanant une voix intérieure. Certes, cette drogue légale met de l’huile dans les rouages, elle lubrifie le compteur kilométrique mais elle ne fait pas tourner le moteur. Courir au-delà de la simple envie de se dégourdir les jambes suppose d’autres motifs de satisfaction. Je ne me suis pas lancé sur ce chemin de croix, d’abord à Bruxelles et bientôt à Londres, juste pour une giclée d’hormones noyées dans un océan de douleur…
A choisir, je préfère l’explication scientifique de l’anthropologue canadien Niobe Thompson, développée dans un documentaire passionnant diffusé en 2012 sur Arte (et visible sur YouTube). Question de départ et titre de son enquête: Sommes-nous faits pour courir? A voir le teint écarlate et le pas mal assuré de certains joggeurs que je croise, on pourrait penser que non. Et pourtant, l’être humain est équipé biologiquement pour galoper durant des heures. Il est même le meilleur coureur de fond de la nature!
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Il faut remonter 3 millions d’années en arrière pour comprendre d’où vient cet avantage génétique, explique le réalisateur au fil de ses rencontres avec les ethnologues et biologistes: à l’époque, nos ancêtres quadrupèdes vivent dans les arbres en Afrique. Une glaciation plus tard et la végétation luxuriante a entièrement disparu. Le pronostic vital de l’espèce est engagé sauf pour quelques malins qui ont l’idée de se redresser sur leurs deux pattes arrières. Problème: comment ce bipède désarmé et fragile va-t-il se nourrir? Le garde-manger n’est plus à portée de main et il est entouré de bêtes féroces ou en tout cas nettement plus rapides que lui.
La sélection naturelle a bien fait les choses puisqu’à défaut de canines tranchantes comme des sabres, elle lui a donné une solide endurance, nettement supérieure à ses concurrents. Par quel miracle? Celui de la régulation thermique. Le circuit de refroidissement de la plupart des mammifères passe entièrement par la bouche et plus précisément par la langue. C’est en haletant qu’ils font baisser leur température corporelle. Or quand un animal pique un sprint, il a le bec cloué. Il est donc obligé de s’arrêter souvent. Alors que l’Homme a la clim intégrée. Toute la surface de sa peau respire et contribue à le garder au frais. Très utile pour la chasse. Il suffit de suivre sa proie au petit trot jusqu’à ce qu’elle s’épuise ou meure d’hyperthermie. Il y a de ça quelques décennie les bushmen pratiquaient encore ce qu’on a appelé la course à l’épuisement.
Physiologiquement, nous n’avons pas beaucoup changé depuis ces temps reculés. Les doigts de pieds courts, la voûte plantaire, le tendon d’Achille et le muscle grand fessier sont parfaitement adaptés aux longues distances, ils agissent comme des ressorts et limitent du même coup la dépense d’énergie. Courir, c’est donc marcher dans les pas de nos ancêtres lointains. C’est retrouver un geste naturel enseveli sous des couches de confort moderne et de sédentarité. Une vision terre à terre qui dissipe un peu le mystère romantique de l’addiction à la course à pied. Mais qui l’inscrit dans une Histoire, la nôtre, et me donne du coup l’air moins givré quand je me lève aux aurores pour affronter les éléments dans mon armure de textile.
Même si ça ne m’aidera sans doute pas beaucoup, je penserai très fort à cette démonstration quand je commencerai à flancher du côté de Tower Hill. J’imaginerai que je suis en train de traquer une antilope dans la savane. Et que ma survie en dépend. A ce moment-là de la course de toute façon, n’importe quelle fable qui permet de gagner quelques mètres est bonne à prendre!
2. Le coin lecture
Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, de Haruki Murakami, éditions 10/18, traduit du japonais par Hélène Morita, 232 pages.
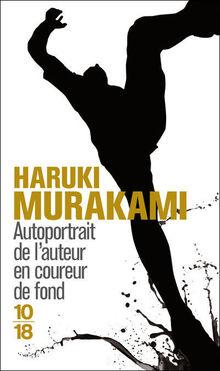
Le Murakami écrivain (La Ballade de l’impossible, 1Q84…), lu dans le monde entier, en cache un autre moins connu, le Murakami marathonien. Ces deux facettes du même personnage sont pourtant étroitement liées. Comme il l’explique dans cet autoportrait en short et baskets, il court parce qu’il écrit. A 30 ans, au début des années 80, il tenait un club de jazz à Tokyo qui marchait plutôt bien. Du jour au lendemain, il revend l’affaire, quitte la ville avec sa femme et décide d’écrire un roman. Pour compenser le manque d’activité physique, il se met à courir. Un sport individuel qui se pratique partout et convient bien à son tempérament un peu bourru comme à son mode de vie nomade. Il devient vite accro.
La preuve, quelques mois plus tard, il se lance, sans véritable préparation et sous prétexte d’en faire un article pour un magazine de jogging, dans une longue chevauchée solitaire sur la route mythique Athènes-Marathon. Il ira jusqu’au bout mais finira en statue de sel carbonisée. Pas de quoi décourager pour autant ce stakhanoviste (il court tous les jours) dont le compteur affiche depuis une vingtaine de marathons pour autant d’années de pratique. Rédigé au cours des quelques mois de 2005 qui précèdent sa participation au mythique 42K de New York, entre Hawaii et Boston en passant par Tokyo, cet essai introspectif entremêle les souvenirs plus ou moins douloureux (dont un ultra marathon de 100 kilomètres vécu comme une expérience quasi mystique dont il reviendra avec un blues monumental) et les réflexions teintées de bouddhisme sur le sens de sa (dé)marche.

Méthodiquement, sans se ménager, l’auteur explore au petit trot le versant existentiel du dépassement de soi, soulignant au passage les ressorts communs de la course à pied et de l’écriture. « Même si le corps n’est pas en mouvement, observe-t-il, à l’intérieur de soi s’opère une dynamique laborieuse et exténuante. Chacun de nous, bien entendu, se sert de son esprit quand il réfléchit. Mais les écrivains endossent un équipement qu’on appelle l' »histoire » ou le « récit » et c’est ainsi vêtus qu’ils pensent, avec leur corps entier; pour l’écrivain, ce travail nécessite qu’il mette en oeuvre toute son énergie physique et bien des fois qu’il aille jusqu’à se surmener.«
Au fil de cette autoanalyse qui révèle la source cachée de son oeuvre et en explique le battement intime se détache une personnalité entière, obstinée, un brin misanthrope aussi, qui place les vertus du travail, de la discipline et de l’effort en surplomb du talent. A sa manière toute japonaise d’embrasser le monde avec sagesse, jusqu’à la mièvrerie parfois, Murakami incarne à la perfection la devise latine « mens sana in corpore sano ».
3. Travaux pratiques
Pour espérer finir un marathon debout, mieux vaut s’y prendre bien à l’avance. Dans cet exercice d’endurance extrême, le lièvre de la fable n’a aucune chance. Il faut non seulement partir à point, mais aussi s’être entraîné soigneusement. Sous peine sinon de s’écraser lamentablement sur le mur des 30 bornes. La volonté seule ne suffit pas. Il faut au préalable assécher le corps, effiler les muscles, les habituer à trimer des heures durant sans se plaindre. Une domestication qui prend au minimum trois mois pour un sportif accompli. Pour le néophyte qui espère boucler les 42 kilomètres sous la barre symbolique des quatre heures, mieux vaut compter quatre à cinq mois de préparation intensive.
Sur la base du résultat honorable de mon premier marathon (3h22 à Bruxelles en octobre dernier), je me suis fixé pour Londres une fourchette entre 3h10 et 3h20. Bonne nouvelle: la capitale anglaise a une poitrine plutôt plate. Je n’aurai donc pas à me farcir l’ascension de l’avenue de Tervuren, ni d’autre col hors catégorie d’ailleurs, d’où mes prévisions optimistes. Pour autant évidemment que la machine ne s’encrasse pas, que le ciel ne me tombe par sur la tête, qu’un embouteillage de guiboles ne me ralentisse pas au départ, que le coeur, les poumons et les muscles jouent la même partition, etc. Bref, que tous les paramètres restent au vert pour que je puisse entièrement me consacrer à la tâche délicate d’emmener ma carcasse jusqu’à destination.
Comme dans les cantines de mon enfance, le menu de l’entraînement ne varie pas beaucoup d’une semaine à l’autre. En gros, j’essaie d’enchaîner une séance intense (15′ d’échauffement et ensuite j’appuie sur l’accélérateur pendant trois quarts d’heure), une séance soft en endurance fondamentale (une bonne heure à 70-75 % de ma fréquence cardiaque maximale), une séance de fractionnés (15′ d’échauffement suivi de séries de 200, 300 ou 400 mètres à plein régime) et enfin une séance longue (minimum 20km) à 80% de mes capacités. Un cocktail classique qui est censé me permettre de combiner endurance et rendement élevé. Pour ne pas ajouter l’ennui à la répétition des exercices, je prends soin d’alterner les décors. La piste, la forêt, la ville ou la promenade verte sont mes différents théâtres d’opération.

A trois mois de la date fatidique, j’entre dans le vif du sujet. Plus de temps à perdre. Tout se joue en effet dans les deux mois qui viennent. Après je lèverai progressivement le pied pour arriver frais et dispos, du moins en théorie, sur la ligne de départ. Tout au long de février, je compte mettre le paquet sur les intervalles. Ce qui ne m’emballe que modérément. Je ne sais pas si c’est l’âge ou une question d’affinité physiologique mais devoir galoper comme si j’avais une meute de pitbulls au derrière, ce n’est pas trop mon truc. Je dois pourtant en passer par là car c’est en montant dans les tours dix, quinze fois de suite qu’on gagne en puissance et qu’on se met à l’abri d’une défaillance au premier plan incliné venu.
Pas de chance, ma séance de mardi s’est mal terminée. J’étais pourtant parti la fleur au fusil, ravi de profiter d’un climat un peu moins humide. Mes pieds caressaient souplement le sol et mes jambes révisaient sans effort leur leçon de géométrie. La première volée d’accélérations d’une minute avait réveillé le palpitant sans m’asphyxier complètement. Tout allait bien. Mais au 9e palier, j’ai reçu un message d’alerte de mon système digestif. C’était comme si une armée de lutins avait allumé un feu de camp dans mes entrailles. Une onde de frissons m’a parcouru des pieds à la tête, laissant dans son sillage un début de nausée. C’est là qu’on prend douloureusement conscience que le corps est une machine de précision hyper fragile. Un peu comme pour une F1, le moindre dérèglement et c’est la sortie de route quasi assurée. Pas du genre à lâcher le morceau, j’ai pourtant continué à tracer ma route, piquant même un dernier sprint. Les passants que j’ai croisés ont dû se demander si j’avais décidé d’en finir avec la vie en me voyant crapahuter comme un possédé, le souffle court, un masque blafard collé au visage. Je n’ai pas demandé mon reste et suis rentré chez moi par le chemin le plus court…
C’est bien ce que je craignais, je traverse en ce moment une zone de turbulences gastriques. La séance en théorie pépère de ce jeudi matin n’a fait que confirmer le diagnostic. Même en mode pianissimo, l’orchestre anatomique jouait faux. Comme si les cuivres pleuraient avec Mahler pendant que les cordes planaient avec Bach.
Je prendrais mon mal en patience si je n’avais une course « officielle » au programme du week-end. Plutôt du genre costaude en plus. Dans mon planning, Les Hivernales et leurs 20 km dans le dédale accidenté de la Forêt de Soignes représentaient une mise en bouche idéale. L’occasion de voir où j’en suis tout en s’en payant une bonne tranche. Sur le papier, ce ne devait déjà pas être une promenade de santé, même si j’avais l’intention de ménager la monture, mais dans mon état fébrile du moment, ce semi-marathon prend des allures de calvaire programmé…
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un débriefing complet.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici